Introduction
Face à l’urgence climatique et à l’instabilité des prix de l’énergie, de plus en plus de maîtres d’ouvrage s’intéressent à des systèmes de chauffage à la fois performants, durables et sobres. Parmi eux, la géothermie sur sondes verticales se distingue comme une solution locale, décarbonée et constante, encore dicrète mais en plein essor.
L’ADEME elle-même a lancé en 2024 une “opération commando géothermie”, pour accélérer le développement de cette filière partout en France, en particulier dans les bâtiments collectifs, scolaires ou tertiaires. Une manière claire de rappeler que cette ressource stable, renouvelable et invisible sous nos pieds mérite enfin toute sa place dans les projets de transition énergétique.
C’est dans ce contexte que j’ai participé à une matinée technique organisée par Odéys et le Pavillon de l’Architecture autour du projet réalisé pour la mairie de Bordes, au cœur du Béarn. Cela m’a permis de mieux comprendre le fonctionnement, les avantages, mais aussi les freins encore existants autour de la géothermie sur sondes verticales. Ce temps d’échange riche entre foreurs, bureaux d’études et collectivités locales m’a donné envie de vous partager les clés essentielles pour bien appréhender ce mode de chauffage écologique.
Dans cet article, je vous propose un tour d’horizon clair et illustré :
- qu’est-ce que la géothermie et quels types existent,
- comment fonctionne une installation de géothermie sur sondes,
- quels en sont les coûts, les contraintes, les aides possibles,
- et dans quels cas elle est vraiment pertinente.

Qu’est-ce que la géothermie ?
La géothermie est une technique qui consiste à utiliser l’énergie naturellement présente dans le sol pour chauffer ou rafraîchir un bâtiment. Cette énergie est captée grâce à un réseau de capteurs, installés soit horizontalement en surface, soit verticalement en profondeur (à l’aide de sondes géothermiques).
L’énergie thermique extraite du sol est ensuite transmise à une pompe à chaleur géothermique, qui la transforme en énergie utile pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire ou le rafraîchissement, selon la saison. Cette énergie est enfin diffusée dans le bâtiment via un plancher chauffant, des radiateurs basse température ou d’autres émetteurs.
Il existe trois types de géothermie, en voici les caractéristiques :

La géothermie sur sondes verticales
Ce système repose sur des forages profonds, généralement entre 50 et 200 mètres. Des sondes verticales y sont insérées pour capter la chaleur à des profondeurs où la température reste stable toute l’année, indépendamment des conditions climatiques.
Les forages sont espacés d’une dizaine de mètres afin d’éviter les interférences thermiques entre les sondes et de garantir une bonne régénération du sous-sol entre les cycles de chauffage et de refroidissement. Certaines entreprises proposent des forages avec des inclinaisons calculées pour pouvoir rapprocher les forages tout en restant dans l’emprise du terrain.
La géothermie verticale offre donc de très bonnes performances, avec un rendement constant et élevé, notamment pour des usages combinés chauffage / rafraîchissement. En revanche, elle est plus coûteuse à l’installation, en raison des forages et des études techniques nécessaires (dimensionnement, test TRT…).
Elle est surtout utilisée dans les bâtiments collectifs ou tertiaires, mais peut être envisagée pour une maison individuelle : certains particuliers font ce choix lorsque le terrain est trop petit pour du capteur horizontal, ou lorsqu’ils souhaitent une solution hautement performante et durable (longévité > 50 ans). Pour une maison individuelle, 1 à 3 sondes de 50 à 100 m de profondeur suffisent selon la puissance nécessaire.
Une solution plus chère mais très efficace, qui valorise le sous-sol sur le long terme.
La géothermie de surface, avec des capteurs horizontaux
C’est la solution la plus courante en maison individuelle. Elle repose sur un réseau de capteurs horizontaux enterrés à faible profondeur, entre 1,2 m et 1,5 m de profondeur minimum et idéalement à moins de 2 mètres. Ce système capte la chaleur présente dans les couches superficielles du sol, dont la température varie plus selon les saisons.
Moins onéreuse que la géothermie profonde, elle ne nécessite pas de forage, ni d’études techniques poussées. Toutefois, ses performances dépendent fortement du climat local et de la nature du sol, ce qui la rend plus sensible aux variations de température. Elle demande également une surface de terrain importante, non bâtie, pour poser les capteurs.
Il faut 1,5 à 2 fois la surface habitable chauffée (ou raffraîchie) en terrain dégagé. Soit environ 200 à 300 m² de terrain libre et non bâti pour une maison standard. Ce terrain ne doit pas être trop boisé ou compacté (réservé pour des parties de type jardin, pelouse, terre végétale…) et il ne doit y avoir aucune construction ni plantation d’arbres une fois le système installé.
Idéal pour les maisons individuelles avec suffisamment de terrain disponible, dans un climat tempéré.
La géothermie sur nappe ou aquathermie
Moins fréquente mais intéressante, la géothermie sur nappe ou aquathermie est un système qui puise directement la chaleur dans une nappe d’eau souterraine.
Elle nécessite deux forages :
- un forage de pompage : pour prélever l’eau dans la nappe,
- un forage de réinjection : pour restituer l’eau dans la nappe à une température réduite, sans la polluer ni la chauffer excessivement ni l’altérer chimiquement.
L’eau est entièrement restituée, elle ne circule que jusqu’à la pompe à chaleur et ne rentre pas à l’intérieur du bâtiment. Elle sert de vecteur thermique.
Ce système offre un très bon rendement, à condition que le débit de la nappe soit suffisant et stable (souvent > 80 m³/h pour les bâtiments collectifs ou tertiaires et 5 à 10 m³/h pour les maisons individuelles). Une étude hydrogéologique est obligatoire, avec test de débit. Il implique aussi des contraintes réglementaires strictes (Directive Cadre sur l’Eau), avec une déclaration obligatoire à la DREAL et un encadrement technique rigoureux.
Les deux forages sont espacés de 15 à 30 mètres minimum, cela dépend du débit, du sol et de l’autorisation délivrée, pour éviter les interférences thermiques (et risquer de re-pomper l’eau que l’on vient de réchauffer). Selon le niveau de la nappe, la profondeur des forages est entre 10 et 50 mètres ce qui est beaucoup moins important que la géothermie sur sondes verticales.
Une solution performante mais réglementée, adaptée à certains contextes géologiques bien spécifiques.
Comment fonctionne une installation de géothermie sur sondes verticales ?
Principe de la géothermie sur sondes verticales
Une installation de géothermie sur sondes verticales repose sur un système en circuit fermé qui capte la chaleur naturellement présente dans le sous-sol. Elle est composée :
- de sondes géothermiques
- enfouies de 50 à 120 m de profondeur pour une maison individuelle et de 70 à 200 m de profondeur pour les bâtiments de bureaux, logements, hôpitaux, etc
- espacées de 7 à 10 mètres entre elles afin d’éviter les interférences entres elles et limiter l’impact sur la température du sous-sol
- faites de deux boucles en U inversé composées en polyéthylène haute densité (PEHD) de diamètre 32 mm
- avec à l’intérieur un fluide caloporteur
- d’une pompe à chaleur eau/eau,
- d’un réseau de distribution thermique :
comme un plancher chauffant basse température (environ 35°C), des radiateurs à eau adaptés (jusqu’à 65°C) ou des panneaux rayonnants.
Ou encore, elle peut être couplée à une CTA qui transmet les calories transmises par le fluide caloporteur pour les diffuser sous forme d’air frais ou d’air chaud. C’est ce que nous avions mis en place avec les bureaux d’études dans un de mes projets pour l’agrandissement d’un réfectoire de plus de 400 élèves.

Fonctionnement saison par saison
- En hiver, le fluide caloporteur descend dans les sondes verticales enfouies profondément et capte la chaleur du sol, relativement constante à ces profondeurs (10 à 15°C). Cette chaleur est transmise à la pompe à chaleur géothermique, qui la valorise pour chauffer l’eau de distribution.
- En été, si le système est réversible, le processus peut être inversé : la chaleur excédentaire du bâtiment est transférée vers le sous-sol, offrant un rafraîchissement passif sans unité extérieure.
Rendement et performance
La pompe à chaleur eau/eau a un rendement très élevé, avec un COP (Coefficient de Performance) supérieur à 4, et souvent un SCOP annuel entre 4 et 5. Cela signifie que pour 1 kWh d’électricité consommée, le système restitue entre 4 et 5 kWh de chaleur ou de fraîcheur.
Lorsque l’on reste sur le système classique avec une pompe à chaleur PAC eau/eau couplé à des émetteurs à fluides, le confort thermique est constant et homogène dans tout le bâtiment, sans bruit ni souffle d’air.
L’étude de faisabilité : une étape obligatoire (et subventionnée)
Avant toute installation de géothermie sur sondes verticales, une étude de faisabilité géothermique est indispensable. Elle permet de dimensionner avec précision le nombre et la profondeur des sondes, en fonction des besoins réels du bâtiment. Elle garantie ainsi les performances du système, évite un sous-dimensionnement ou un surcoût inutile, et assure la viabilité du projet à long terme.
Cette étude analyse :
- les besoins thermiques du bâtiment,
- les caractéristiques du sol (géologie, humidité, conductivité thermique),
- la faisabilité du forage et, si nécessaire, un test de réponse thermique (TRT) pour affiner le dimensionnement.
Elle doit obligatoirement être menée par un bureau d’étude certifié OPQIBI 10.07, notamment si vous souhaitez accéder aux aides financières telles que le Fonds Chaleur de l’ADEME. Vous aurez trois intervenants : un BE sous-sol1, un BE surface2 et un foreur3.
Le coût de cette étude peut être subventionné jusqu’à 70 %, selon les régions et dispositifs.
Il y a trois grandes phases (dont une optionnelle) dans cette étude :
- PHASE 1 : DIAGNOSTIC ET PROPOSITIONS TECHNIQUES (Lancement et audit énergétique)
- Description du cadre général de l’opération
- Etude des besoins thermiques chaud/froid
- Enquête géologique et hydrogéologique
- Contexte réglementaire
- Evaluation géothermie sur sondes et évaluation installations de surface
- PHASE 2 : FORAGE D’UNE SONDE TEST ET TRT4 (Optionnel)
- Forage (par une entreprise qualifiée RGE Qualiforage sonde)
- Réalisation de la mesure TRT
- Interprétation des résultats du test
- PHASE 3 : EVALUATION TECHNIQUE ET ECONOMIQUE DE LA SOLUTION RETENUE
- Coûts d’investissements et d’exploitation
- Analyse économique
- Bilan environnemental
- Planning prévisionnel
Étude de cas : Espace Terre d’Envol à Bordes
Contexte du projet
La commune de Bordes, engagée dans une démarche de sobriété énergétique et de revitalisation du bâti du centre bourg, a lancé le projet de l’Espace Terre d’Envol. C’est une réhabilitation ambitieuse de deux anciennes granges au coeur du village avec une extension neuve permettant de les relier. Ce nouvel équipement de 650 m² regroupera les services administratifs de la mairie, des espaces de coworking, des salles à vocations multiples et des permanences sociales. Pensé comme un lieu de vie et de ressources, ce bâtiment illustre la volonté municipale d’allier utilité sociale et performance environnementale.

Un bel exemple de rénovation énergétique et architecturale.
Choix de la géothermie et configuration technique
Pour le chauffage et le rafraîchissement, la commune a opté pour une géothermie sur sondes verticales, une solution écologique, discrète et performante adaptée aux besoins de ce bâtiment multi-usages. L’installation repose sur 4 sondes verticales de 140 mètres de profondeur, reliées à une pompe à chaleur eau/eau d’une puissance de 26 kW.
Ce système en circuit fermé permet de couvrir les besoins thermiques du bâtiment avec un excellent rendement : le SCOP mesuré atteint 4,51, témoignant d’une efficacité remarquable sur l’année.
Partenaires et ingénierie
Le projet a mobilisé plusieurs acteurs spécialisés :
- APGL64 pour la maîtrise d’œuvre
- PIK Ingénierie & GEOTHERMAQ pour les études et le suivi de la géothermie
- FNCOFOR (Fédération nationale des Communes forestières) pour l’accompagnement à la maîtrise d’énergie.
Financement et retour d’expérience
Ce projet de géothermie de bâtiment public a bénéficié de multiples subventions de l’ADEME, la Région Nouvelle-Aquitaine, le FEDER, le Conseil Départemental 64 et la Communauté de Communes Pays de Nay, avec une aide à l’étude de faisabilité et à l’installation.
Ce qui leur fait un reste à charge de 26 000 € HT pour les 114 000 € HT d’investissement sur le système de géothermie seul. Ce retour d’expérience confirme que la géothermie peut être économiquement et techniquement viable pour des bâtiments publics de taille moyenne, surtout lorsqu’elle est intégrée dès la phase de conception.

Avantages et limites de la géothermie sur sondes verticales
Voici les principaux atouts — et limites — identifiés à travers les retours d’expérience et l’analyse des projets géothermiques existants.
Les avantages de la géothermie
Énergie locale, stable et renouvelable ♻️
La géothermie sur sondes capte l’énergie naturellement présente dans le sol, toute l’année, à une température stable entre 10 et 15°C dès 10 à 15 mètres de profondeur. Elle permet de se chauffer ou rafraîchir sans combustion ni transport, en utilisant une ressource locale, invisible et renouvelable. Cela contribue à réduire la dépendance aux énergies fossiles, tout en valorisant le sous-sol de manière passive.
Chauffage et rafraîchissement 🔥 ❄️
Grâce à une pompe à chaleur réversible, le même système peut produire de la chaleur en hiver et du rafraîchissement en été. C’est un vrai confort thermique toutes saisons, avec une température douce et constante dans les pièces. Ce double usage augmente la rentabilité du système sur l’année et évite de déséquilibrer le sous-sol sur le long terme.
Rendements élevés (COP5 > 4 ) 📈
Le Coefficient de Performance (COP) d’une pompe à chaleur géothermique dépasse souvent 4, ce qui signifie que pour 1 kWh d’électricité consommée, l’installation restitue plus de 4 kWh de chaleur. Ce rendement élevé permet de réduire la facture énergétique sur le long terme, surtout en comparaison avec un chauffage électrique classique ou une chaudière à fioul.
Discrète, sans impact paysager 🌿
Une fois les sondes verticales enfouies, tout disparaît dans le sol (hormis la pompe à chaleur à placer dans un local technique ou dans un garage). Contrairement à des capteurs solaires ou des unités extérieures de PAC air/air, la géothermie n’altère ni la façade, ni le toit, ni le paysage. Cela en fait une solution idéale pour les projets en secteur protégé ou les bâtiments à forte valeur patrimoniale.
Maintenance faible 🛠️
La partie enterrée du système (les sondes) est quasiment inusable : sans pièce mobile, sans corrosion, elles peuvent durer plus de 50 ans. Seule la pompe à chaleur nécessite un entretien régulier, mais bien moindre que celui d’une chaudière. C’est un système fiable, silencieux et durable, avec très peu d’interventions à prévoir.
Longévité des sondes > 50 ans ♾️
Les sondes géothermiques sont conçues pour durer plusieurs décennies. Leur longévité permet d’amortir l’investissement initial sur le long terme avec une durée de vie bien supérieure à 50 ans, d’autant plus qu’elles ne nécessitent pas de remplacement à moyen terme. Il suffit de changer la PAC au bout de 15 à 20 ans pour redonner un second souffle à l’installation et prolonger la durée de vie du système.
Particulièrement rentable pour des bâtiments mutualisés ou de grande surface 🏘️ 🏫
La géothermie prend tout son sens sur des projets de grande emprise comme les écoles, collèges, bureaux, logements collectifs ou quartiers pavillonnaires, où les besoins en énergie sont constants avec une demande de chauffage l’hiver et de rafraîchissement l’été. Plus le réseau est mutualisé, plus l’installation est optimisée, ce qui améliore le rendement global et réduit le coût par m² chauffé.
VS les inconvénients de la géothermie
Coût d’installation élevé 💸
Le principal frein reste le coût initial important, en particulier pour le forage, qui peut atteindre 100 à 200 €/m linéaire. L’installation complète revient souvent plus cher qu’une PAC air-eau ou qu’une chaudière, surtout en maison individuelle. Ce surcoût est toutefois amorti dans le temps, à condition que le bâtiment soit bien isolé avec un projet global de rénovation énergétique ou un projet de mutualisation des besoins.
Empreinte carbone initiale du forage 💨
Même si la géothermie est performante à l’usage, son impact carbone initial (lié au forage, matériaux plastiques, béton, énergie grise) doit être pris en compte. En général, il est compensé en quelques années d’usage, surtout si le bâtiment est bien isolé et les besoins réguliers.
Pour rester cohérent écologiquement, le système doit être justement dimensionné, intégré dans un projet global, et optimisé.
Nécessite des études techniques poussées 📊
Un projet géothermique exige une étude de faisabilité certifiée, un dimensionnement précis, parfois un test de réponse thermique (TRT), et une autorisation de forage. Ce sont des démarches longues et coûteuses, qui nécessitent un accompagnement par des bureaux d’études spécialisés (OPQIBI 10.07 par exemple).
Moins adaptée aux rénovations lourdes sans gros travaux 🏚️
La géothermie donne les meilleurs résultats dans des bâtiments très bien isolés. Sur des projets de rénovation partielle, ou si l’isolation reste faible, le rendement de la PAC peut chuter et l’intérêt économique devient discutable. Il faut donc intégrer la géothermie dans une rénovation énergétique globale, pas en isolation.
Demande un terrain libre d’emprise 📏
Les sondes verticales nécessitent un espace libre pour le forage et un certain éloignement entre elles (10 m en pose verticale stricte mais il existe des forages avec des poses avec un légère inclinaison). En site contraint ou dense, cela peut s’avérer impossible, ou entraîner des surcoûts importants. Le terrain doit être accessible au forage, sans contraintes majeures comme la présence de réseaux, roches explosives, ou zones protégées.
PAC à remplacer tous les 20 ans environs ⌛
Si les sondes sont durables, la pompe à chaleur, elle, devra être remplacée au bout de 15 à 20 ans. Cela représente un coût à anticiper, même si le remplacement est moins complexe que l’installation globale avec le forage initial.
Complexité administrative et réglementaire (DREAL, études, etc.) 🗂️
La géothermie profonde est soumise à des autorisations strictes (déclaration à la DREAL, étude d’impact selon les cas). Cela demande du temps, de la rigueur, et un accompagnement administratif solide par des professionnels expérimentés.
Financer un projet de géothermie : quelles aides disponibles ?
Installer une géothermie sur sondes représente un investissement conséquent, surtout en maison individuelle. Heureusement, plusieurs dispositifs de financement existent, adaptés à tous les profils de porteurs de projet : particuliers, entreprises privées ou collectivités publiques.

Parmi ces dispositifs, vous trouverez :
- Le Contrat Chaleur Renouvelable, piloté par l’ADEME, soutient les projets de géothermie via le Fonds Chaleur.
- Des subventions sont accessibles en fonction du type d’installation : pompe à chaleur, réseau mutualisé, usage collectif ou individuel.
- Des aides régionales, départementales et nationales selon pour les bénéficiaires publics comme privés, avec des aides spécifiques selon les cas.
- Des dispositifs locaux de soutien à la transition énergétique
- Un accompagnement est possible avec des animateurs EnR dans certaines régions ou intercommunalités, pour guider les démarches.
À savoir : pour être éligible aux aides publiques (ADEME, Région, Département…), il est indispensable de confier l’étude de faisabilité à un bureau d’études certifié OPQIBI 10.07. Cette étude peut elle-même être subventionnée jusqu’à 70 %, ce qui réduit considérablement le coût de l’installation.
Pour le projet de géothermie de la mairie de Bordes, c’est Territoire d’énergie Pyrénées Atlantiques qui ont accompagnée la commune dans les démarches de demandes d’aide.
Il y a deux catégories d’aides dans le Contrat Chaleur Renouvelable Territorial :
- Aide à la décision :
- 70% de subventions sur les études de faisabilité
- 70% de subventions sur les AMO6
- Aide à l’investissement :
- Pour la production d’énergie : Géothermie (< 2 000 MWh/an), Solaire thermique (< 500m2) et Biomasse énergie (< 12 000 MWh/an)
- Pour la distribution d’énergie : Réseau de Chaleur et froid (plafonds d’aide en €/ml selon les dimensions du réseau)
Pour toute démarche de géothermie, les démarches administratives et l’accompagnement de bureaux d’études qualifiés sont indispensables.
Conclusion : pourquoi envisager la géothermie aujourd’hui ?
Pour les collectivités, les bâtiments mutualisés ou les projets de construction neuve bien anticipés, la géothermie offre une réponse concrète, locale et silencieuse à la crise énergétique. Avec un système bien pensé, un bon dimensionnement, une isolation performante et une vraie réflexion sur les usages, l’investissement financier et l’impact écologique sont amortis plus vite. Cette solution s’inscrit alors dans une stratégie globale de durabilité et de sobriété et d’optimisation énergétique.
Ce que nous montrent les retours d’expérience comme celui de Bordes, c’est que ce type de système devient de plus en plus accessible grâce aux subventions dont le Contrat de Chaleur Renouvelable, à l’accompagnement des collectivités et à la montée en compétence des professionnels.

Pour les particuliers, elle reste un choix exigeant avec un investissement important et une installation lourde, mais elle sera très rentable et permettra de décarboner sur le long terme.
Dans tous les cas, il est essentiel de se faire accompagner par des professionnels compétents, de s’assurer du bon dimensionnement du système, et d’intégrer la géothermie dans une réflexion globale sur la performance énergétique.

Cela dépendra de votre terrain, de votre projet, et de votre vision. Mais une chose est sûre : le potentiel est bien là, sous nos pieds. À nous de savoir le révéler intelligemment dans les situations opportunes.
Merci à vous d’avoir lu cet article ! 😊
N’hésitez pas à me poser des questions ou à me parler de vos expériences en commentaire 🌱
Si vous êtes déjà prêt·e à vous lancer, parlons de votre projet autour d’un café (virtuel ou réel).
➡️ Me contacter – Papaya Architecture
💌 Abonnez-vous à ma newsletter pour recevoir des retours d’expérience inspirants, des conseils pratiques et des ressources concrètes.
FAQ sur la géothermie
Est-ce que la géothermie est adaptée à une maison individuelle ? 🏡
Oui, à condition que le terrain et le projet s’y prêtent. En maison, on opte généralement pour des capteurs horizontaux (moins chers mais plus gourmands en surface) ou pour des sondes verticales si l’on manque d’espace ou si l’on cherche une performance optimale.
Quelle est la différence entre géothermie verticale, horizontale et sur nappe ? 💧
La géothermie horizontale capte la chaleur dans les couches superficielles du sol via un réseau enterré. La géothermie verticale utilise des sondes profondes, plus coûteuses mais très stables. Celle sur nappe exploite une nappe phréatique existante avec un double forage pour pomper et réinjecter l’eau.
Combien coûte une installation géothermique ? 💶
Le coût dépend de nombreux facteurs : type de sol, profondeur des sondes, puissance nécessaire, accessibilité du terrain, type d’émetteurs (plancher chauffant ou radiateurs), etc. Pour une maison individuelle, il faut prévoir un budget entre 30 000 et 55 000 € TTC pour une installation complète (sondes + PAC + distribution intérieure).
À cela peuvent s’ajouter : 5 000 à 10 000 € pour l’étude de faisabilité géothermique (souvent subventionnée jusqu’à 70 %) ainsi que les frais de terrassement, local technique ou adaptation du réseau intérieur.
Les aides financières (comme le Fonds Chaleur, aides régionales, MaPrimeRénov’ pour la PAC uniquement) permettent de réduire le reste à charge, mais le coût initial reste élevé. D’où l’intérêt de ce type de solution pour des bâtiments bien dimensionnés, avec des besoins constants, ou dans une logique de bâtiment à très longue durée de vie.
Quelle est la durée de vie d’un système géothermique ? ⏳
Les sondes enterrées durent plus de 50 ans sans entretien. Seule la pompe à chaleur doit être remplacée tous les 15 à 20 ans environ. C’est donc un investissement durable et peu gourmand en maintenance.
Est-ce que la géothermie fonctionne quand il fait très froid ? 🧊
Oui, c’est même l’un de ses points forts ! Contrairement à une pompe à chaleur air/eau, la géothermie puise la chaleur dans un sol à température constante, ce qui garantit un rendement stable même en hiver.
Peut-on aussi rafraîchir un bâtiment avec la géothermie ? ❄️
Absolument, à condition de choisir une pompe à chaleur réversible. En été, la chaleur est “stockée” dans le sol, ce qui permet de rafraîchir naturellement le bâtiment sans climatisation énergivore.
Quels sont les avantages écologiques de la géothermie ? ♻️
C’est une énergie renouvelable, locale et discrète. Elle n’émet quasiment pas de CO₂ à l’usage, ne dépend pas des importations, et valorise le sous-sol sans l’épuiser.
Faut-il forcément un grand terrain pour faire de la géothermie ? 🧭
Pas nécessairement. Pour la géothermie verticale, il suffit de quelques mètres carrés pour forer. En revanche, les capteurs horizontaux pour la géothermie de surface demandent beaucoup plus de surface libre (jusqu’à 2 fois la surface habitable).
Quelles aides financières existent pour un projet géothermique ? 💰
L’ADEME, les Régions et certains Départements soutiennent les projets via le Fonds Chaleur, le Contrat Chaleur Renouvelable (ou MaPrimeRénov’ pour la partie pompe à chaleur uniquement et sous conditions). L’étude préalable peut être financée jusqu’à 70 % si elle est menée par un bureau d’étude certifié OPQIBI.
Est-ce que la géothermie est rentable ? 📈
Oui, surtout sur le long terme. L’investissement initial est élevé, mais les économies d’énergie, la stabilité des prix, le rendement, la longévité des équipements et les aides disponibles rendent la géothermie très intéressante, notamment en rénovation performante ou en construction neuve.
- BE sous-sol : Bureau d’études spécialisé dans la géologie, les forages, et la caractérisation du sous-sol. Il dimensionne les sondes géothermiques en fonction du terrain. ↩︎
- BE sous-sol : Bureau d’études spécialisé dans la conception des systèmes en surface (PAC, distribution, émetteurs…), l’enveloppe du bâtiment, et l’analyse des besoins thermiques. ↩︎
- Foreur : Entreprise ou professionnel certifié qui réalise les forages profonds nécessaires à l’installation des sondes verticales. Il intervient après validation de l’étude géothermique.
↩︎ - Le TRT est un Test de Réponse Thermique, c’est un test in situ mesurant la conductivité thermique du sol pour dimensionner précisément une sonde géothermique verticale. ↩︎
- Le COP (Coefficient de Performance) mesure le rendement d’une pompe à chaleur. Par exemple, un COP de 4 signifie que pour 1 kWh d’électricité consommé, la PAC restitue 4 kWh de chaleur.
Plus le COP est élevé, plus le système est performant et économe en énergie. ↩︎ - AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) : accompagnement technique, administratif ou stratégique du maître d’ouvrage pour l’aider à piloter son projet, sans se substituer à lui. ↩︎






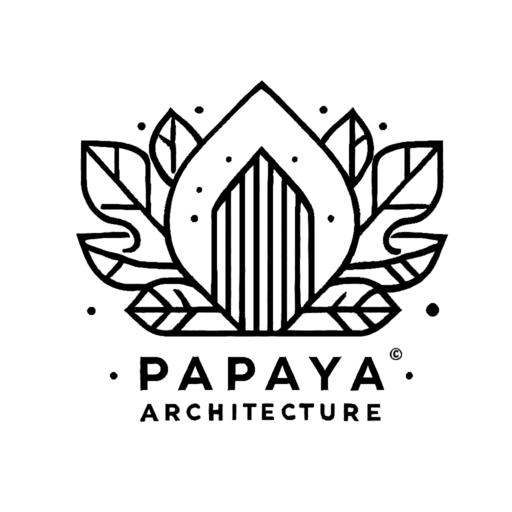




Laisser un commentaire