Introduction
Et si votre maison pouvait s’adapter au climat plutôt que de lutter contre lui ?
Dans notre monde moderne, on a souvent oublié ce bon sens ancestral qui guidait les bâtisseurs d’autrefois : concevoir une maison en harmonie avec son environnement.
Je me souviens encore de mon premier semestre à l’école d’architecture où l’on nous faisait travailler uniquement sur l’environnement, l’espace, avec un nombre limité de parois verticale, parfois aucune paroi horizontale. La seule contrainte était le lieu. Nous devions concevoir avec une réflexion sur l’impact de notre architecture par rapport à son environnement : son orientation, son adaptation au terrain naturel et à ses pentes, anticiper la trajectoire du soleil et travailler les jeux d’ombre et de lumière, imaginer les vues sur le paysage qu’on y retrouverait…
Cette première approche qui pouvait paraître bien simpliste avait pourtant tout son sens : le développement du dialogue entre l’architecture et son environnement.
Aujourd’hui, beaucoup de constructions « modernes » négligent cette relation essentielle. Mauvaise orientation, matériaux mal choisis, volumes mal proportionnés… Résultat : on compense par la technique. Chauffage surdimensionné, climatisation dans chaque pièce, convecteurs inefficaces, isolants polluants… avec des conséquences lourdes : factures salées, inconfort, et impacts environnementaux non négligeables (sans compter les impacts sur la santé des ouvriers et des occupants).
L’architecture bioclimatique, au contraire, anticipe les besoins du bâtiment. Elle cherche l’équilibre entre confort, sobriété énergétique et respect du climat local. Elle s’appuie sur une conception fine, dès l’esquisse, pour que le bâtiment profite naturellement de son environnement.
Dans cet article, je vous propose de découvrir ce qu’est l’architecture bioclimatique en commençant par sa définition, ses avantages, ses principes fondamentaux et leur mise en application pour imaginer votre future maison autrement.
Qu’est-ce que l’architecture bioclimatique ?
L’histoire de l’architecture bioclimatique 📜
Étymologie et principes de base 🏛️
Le terme bioclimatique vient du grec bios (vie) et klima (climat). L’architecture bioclimatique désigne donc une architecture pensée en lien direct avec la vie et le climat, cherchant le meilleur parti entre les usages des habitants et les conditions naturelles en limitant les dépenses énergétiques. Cette approche implique une conception intégrée entre les habitants, le lieu et l’enveloppe du bâtiment (matériaux, forme, orientation…).

Les origines de l’architecture bioclimatique 🛖
Depuis la préhistoire, les humains se sont adaptés au climat et se sont constitué peu à peu des peaux supplémentaires avec l’usage de fourrure puis la création d’habitats. A la recherche du confort thermique, ils ont su adapter leur habitat aux contraintes climatiques locales et aux changements de saison.
Les habitats traditionnels dans le monde entier témoignent d’une intelligence climatique intégrée : murs épais et petites ouvertures en régions chaudes, orientation spécifique, matériaux locaux, gestion passive de l’air et de la lumière…
Ces constructions étaient low-tech, frugales et efficaces, souvent conçues sans apport d’énergie extérieure. Ce savoir-faire s’est transmis pendant des siècles avant d’être marginalisé par l’arrivée des énergies fossiles et des équipements actifs.

Exemples : les igloos, les maisons troglodytes, les constructions en pisé, les toitures végétalisées ou les dispositifs de rafraîchissement passif en Méditerranée (puits de lumière, patios, murs à forte inertie thermique…).
L’influence de la crise pétrolière ⛽
A la veille du choc pétrolier de 1973, le monde avait oublié la contrainte thermique. L’énergie avait un faible coût, les machines thermiques étaient en pleine expansion et c’était l’ère du développement industriel de l’habitat et des buildings d’acier et de verre.
Le mode de vie des habitants a évolué vers plus de confort, vers plus de chauffage, vers plus d’équipements électroménagers, l’arrivée des équipements électroniques, etc.
La flambée du prix de l’énergie a permis une prise de conscience mondiale sur la dépendance énergétique des bâtiments modernes et la vulnérabilité du modèle industriel basé sur des ressources fossiles.
Cela a ravivé l’intérêt pour une architecture sobre en énergie, s’inspirant des logiques vernaculaires. On voit alors émerger les premières expérimentations de constructions bioclimatiques dans les pays industrialisés, en particulier en Europe et aux États-Unis.
Quelques exemples notables :
– La maison solaire passive de Team Ten (1974)
– Les Earthships de Michael Reynolds (Nouveau-Mexique)
– Les projets pilotes en paille, terre crue ou bois local à faible impact

L’évolution actuelle de l’architecture bioclimatique 🌿
Depuis les années 2000, les impacts du changement climatique et la raréfaction des ressources ont relancé un intérêt croissant pour l’architecture bioclimatique et surtout un engagement des différents partis politiques. Les États s’engagent aujourd’hui publiquement dans des stratégies de diminutions de leur empreinte carbone.
En France, le secteur du bâtiment représentait 35 à 40% des émissions de gaz à effet de serre dans les années 2000, c’est donc un levier important dans la lutte contre le changement climatique. Et cela passe par la mise en application de réglementations thermiques et environnementales dans la construction (RT2012 puis RE2020) et l’incitation à la rénovation énergétique du parc immobilier existant. Grâce à ces mesures, nous sommes aujourd’hui descendus à 23%.
Aujourd’hui l’architecture bioclimatique contemporaine allie :
- Les enseignements des savoir-faire vernaculaires
- Les recherches scientifiques (thermique, hygrométrie, matériaux biosourcés…)
- Et des techniques modernes de simulation, de construction, voire d’auto-construction

Définition de l’architecture bioclimatique 📚
Le but de l’architecture bioclimatique est de concevoir une architecture qui offre confort et bien-être à ses habitants tout en respectant l’environnement avec une réduction maximale des dépenses énergétiques. Cela passe par une démarche bioclimatique avec les objectifs spécifiques suivants :
- L’insertion dans le territoire 🏞️
Concevoir une construction en adéquation tant avec le climat et l’environnement local qu’avec les modes et différents rythmes de vie de ses occupants afin d’avoir un bâtiment le mieux adapté :- au climat hivernal : avec la captation de calories gratuites par les apports solaires tout en limitant les déperditions thermiques.
- au climat estival : en maximisant la ventilation naturelle (rafraîchissement gratuit et écologique) tout en limitant les surchauffes dues à l’exposition solaire.
- La sobriété d’usage et les économies d’énergie 🕯️
Créer ce bâtiment en adéquation avec les modes d’occupation des usagers et les systèmes internes (modes de chauffage et de régulation) afin de limiter les besoins de chauffage ou de rafraîchissement. - L’usage de matériaux biosourcés 🌾
Construire avec des matériaux naturels, issus de l’environnement et le moins transformés possible afin de limiter l’impact carbone de la construction. - La propreté du chantier 👷🏼
L’usage de matériaux biosourcés favorise un chantier propre et limite les impacts environnementaux, le bilan écologique du bâtiment n’en est que meilleur et la santé des ouvriers également. - Le confort et la santé des occupants 😌
L’usage de matériaux biosourcés couplé à de bonnes stratégies d’orientation et énergétiques apporte une meilleure santé aux occupants : une meilleure qualité de l’air intérieur, un meilleur confort, un meilleur bien-être, une diminution des risques d’état grippaux dus à la climatisation, une diminution des risques d’électrosensibilité,..
Architecture bioclimatique, architecture solaire, architecture passive, BEPOS, HQE, quesako ? 🧐
Architecture bioclimatique 🌿
À la différence de l’architecture passive, l’architecture bioclimatique n’est pas liée à un label ou à des performances chiffrées. Il s’agit avant tout d’une approche de conception intelligente, qui vise à tirer parti du climat local pour maximiser le confort tout en réduisant les besoins énergétiques. On parle ici de bon sens architectural : orientation optimisée, gestion des apports solaires, inertie thermique, ventilation naturelle, etc. C’est une démarche plus souple, adaptée au contexte du terrain et à l’usage, accessible même sans certification.
Architecture solaire ☀️
On parle aussi parfois d’architecture solaire, une approche qui consiste à exploiter directement l’énergie solaire dans la conception d’un bâtiment. Elle peut prendre plusieurs formes :
- Solaire passif : utilisation du soleil sans technologie mécanique (par exemple, grandes baies vitrées orientées au sud, murs capteurs, serres bioclimatiques…). L’objectif est d’accumuler de la chaleur naturellement et de la redistribuer à l’intérieur du bâtiment.
- Solaire actif : intégration de technologies de captage de l’énergie solaire, comme les panneaux photovoltaïques ou les capteurs solaires thermiques pour produire de l’électricité ou chauffer l’eau.
L’architecture solaire passive est donc une composante de l’architecture bioclimatique, qui elle-même englobe une réflexion plus globale sur le climat, les vents, l’humidité, la lumière, etc.
En revanche, le solaire actif peut être utilisé dans n’importe quelle architecture, même peu écologique, s’il est seulement greffé sans réflexion globale de conception

Architecture passive ❄️
L’architecture passive fait généralement référence à une démarche certifiée, notamment selon le label Passivhaus (ou maison passive), développé en Allemagne dans les années 1990. Pour qu’un bâtiment soit considéré comme passif, il doit répondre à des exigences techniques très strictes, comme :
- une consommation de chauffage inférieure à 15 kWh/m²/an
- une consommation énergétique totale inférieure à 120 kWh/m²/an
- une étanchéité à l’air très performante
- une ventilation double flux avec récupération de chaleur
- une super-isolation et des vitrages très performants
Ce n’est pas une approche « au feeling » ou contextuelle, mais une méthode rigoureuse avec objectifs chiffrés. Il est possible de construire une maison passive sans certification, mais on sort alors de la définition stricte du terme.
BEPOS (Bâtiment à Énergie Positive) ⚡
De leur côté, les bâtiments à énergie positive (BEPOS) vont encore plus loin que le passif : ils produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment sur une année. Cette performance passe souvent par l’ajout de panneaux solaires, une très haute performance de l’enveloppe, et des équipements techniques performants. C’est une approche très technique, souvent utilisée pour des bâtiments publics, tertiaires ou des logements très performants.

HQE (Haute Qualité Environnementale) ♻️
Enfin, la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) est un cadre global d’évaluation de la qualité environnementale d’un bâtiment. Elle ne se limite pas aux consommations d’énergie : elle prend en compte l’impact du bâtiment sur la santé, le confort, la gestion de l’eau, des déchets, les matériaux utilisés, etc. C’est une démarche plus large, souvent utilisée dans le tertiaire ou les équipements publics.
Quels sont les avantages de l’architecture bioclimatique ?
Un confort thermique été comme hiver ☀️ ❄️
L’un des piliers de l’architecture bioclimatique, c’est le confort thermique par une conception bien réfléchie. Le confort est naturel et stable ainsi les occupants obtiennent un ressenti plus fort du confort thermique. Il n’est pas compensé par une climatisation réversible bruyante et énergivore.
Dès l’implantation, le bâtiment est orienté afin de capter les rayonnements solaires l’hiver. Les dispositifs architecturaux et végétaux lui permettent de s’en protéger l’été. L’isolation et l’usage judicieux de matériaux à forte inertie permettent un stabilité de température intérieure, douce et homogène toute l’année, tout en limitant les besoins en énergie.
Une réduction des besoins énergétiques 🔋
Un bâtiment bioclimatique doit être pensé avec l’environnement local. En évoluant frugalement à travers les saisons avec des dispositifs intelligents, sa consommation d’énergie est réduite au maximum.
En été, une ventilation naturelle bien conçue évite de recourir à la climatisation. En hiver, les apports solaires passifs limitent l’utilisation du chauffage. Et tout au long de l’année, l’éclairage naturel bien réparti permet de moins utiliser la lumière artificielle.
Ce mode de conception permet de réduire significativement les factures d’énergie, mais aussi de gagner en autonomie : certains bâtiments bioclimatiques, bien accompagnés de dispositifs comme des panneaux solaires ou des poêles à bois efficaces, peuvent aller jusqu’à tendre vers l’autonomie énergétique.
C’est une façon concrète de reprendre le contrôle sur sa consommation, de se protéger des hausses de prix, et de faire un pas de plus vers la résilience.
Une meilleure qualité de vie et de bien-être 😌
L’architecture bioclimatique ne se limite pas à la technique : elle touche au vivre, au ressenti, à la connexion avec la nature.
Vivre dans un habitat pensé en lien avec le climat et les éléments, c’est profiter d’une lumière naturelle abondante, de vues ouvertes sur le paysage, d’une bonne qualité de l’air intérieur, d’un silence agréable, et encore mieux avec l’usage de matériaux biosourcés et géosourcés, sains, locaux, peu émissifs.
Tout cela contribue à une ambiance intérieure apaisante, qui favorise le bien-être physique et mental. On s’y sent bien, ancré, à sa place.
C’est un habitat qui respecte le rythme du jour et des saisons, qui invite à ralentir, à observer, à habiter pleinement son espace. En somme, un cadre de vie harmonieux, propice à la santé et à l’équilibre.
Une valorisation de l’architecture (et à la revente !) 🏡
Choisir une démarche bioclimatique, ce n’est pas juste “faire une maison écolo”. C’est concevoir un projet unique, adapté à son site, à son climat, à ses usages.
Cette approche sur mesure, profondément ancrée dans le territoire, donne souvent naissance à une architecture singulière, sensible et durable.
Elle met en valeur l’intelligence de la conception, la cohérence globale du projet, et traduit une forme d’engagement esthétique et éthique.
Et ce n’est pas qu’une question de convictions : à la revente, ce type de bâtiment est de plus en plus recherché. Les futurs propriétaires sont attentifs à la performance énergétique, à la qualité de vie, et à la valeur ajoutée qu’apporte une conception réfléchie. L’architecture bioclimatique, loin d’être une contrainte, est une source d’innovation et de créativité qui séduit aussi bien le cœur que la raison avec une facture d’énergie minimisée.
Une diminution de l’impact environnemental 🌍
Enfin, impossible de parler bioclimatisme sans parler de son empreinte écologique réduite.
En minimisant les besoins en énergie, en favorisant l’usage de matériaux locaux, biosourcés ou recyclés, en limitant les déchets de chantier, et en prolongeant la durabilité des bâtiments, cette approche s’inscrit dans une logique vertueuse.
Elle contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à préserver les ressources naturelles, tout en favorisant des savoir-faire locaux.
C’est une architecture qui respecte les cycles de la nature, qui privilégie la sobriété heureuse, et qui propose des solutions concrètes pour habiter la planète autrement, avec responsabilité et sens.
Les principes fondamentaux de l’architecture bioclimatique
Une réflexion autour de l’orientation du bâtiment 🧭
La base d’un projet d’architecture bioclimatique est de choisir son implantation selon les atouts naturels du terrain et du climat local. L’orientation d’un bâtiment bioclimatique influencera son confort thermique et ses performances énergétiques.
On va donc rechercher à utiliser les atouts du site pour :
- Profiter de l’ensoleillement hivernal tout en évitant les surchauffes estivales 🌞
En orientant le bâtiment vers le sud pour capter les apports solaires (chauffage et lumière) tout en intégrant des protections pour la saison estivale avec des débords de toit correctement dimensionnés, des pergolas sur lesquelles grimpent des végétaux l’été ou des arbres caducs bien positionnés. - Protéger les façades exposées au vents dominants et aux fortes pluies ⛈️
Cela est propre à chaque zone géographique, dans le sud-est, on se protègera du mistral qui vient du Nord-Ouest. Tandis que dans ma région, on protège les façades Ouest et Sud-Ouest du mauvais temps.
Une bonne orientation évitera les risques de pertes thermiques et d’infiltration d’eau.

De plus, il est important de prendre en compte les orientations solaires dans le choix des ouvertures mais aussi des vitrages. Un compagnon menuisier saura vous faire des vitrages spécifiques au-delà du choix de simple, double ou triple vitrage. Il y a des réglages d’épaisseur de vide d’air, d’épaisseur de verre et de choix de traitement du vitrage pour optimiser l’isolation thermique et la transmission lumineuse d’une fenêtre ou d’une baie vitrée.
| Orientation | Ensoleillement | Risques climatiques régionaux | Conseils bioclimatiques |
| Nord | Très faible, froid | Froid, humidité, moisissures | Murs très isolés, peu d’ouvertures |
| Nord-Est | Faible le matin | Vent frais | Petites ouvertures, bonne isolation |
| Est | Bon le matin | Peu de risques | Fenêtres idéales pour les chambres |
| Sud-Est | Très bon le matin | Surchauffe légère en été | Prévoir protections solaires légères |
| Sud | Excellent en hiver, intense en été | Surchauffe en été | Apports solaires avec casquettes ou végétation caduque |
| Sud-Ouest | Bon en hiver, fort en été | Surchauffe + vents pluvieux | Protéger contre la pluie + casquettes efficaces |
| Ouest | Fort en fin de journée | Pluies fortes, vent dominant | Limiter les baies vitrées, bardage résistant |
| Nord-Ouest | Faible à moyen | Pluies et vents d’ouest | Murs robustes, débords de toit, peu de vitrages |
L’optimisation de la forme architecturale 📐
Les parois étant plus ou moins déperditives selon leur orientation, le second paramètre va être leur dimension. En effet, selon la taille des surfaces exposées, nous aurons une forme plus ou moins optimale. L’objectif est donc de travailler plus ou moins la compacité de notre bâtiment, toujours selon le climat local.
Ainsi pour un même volume, nous n’aurons pas la même surface de parois extérieures. Donc entre une maison très compacte cubique et une maison très allongée, orientées toutes les deux vers le sud, l’une recevra deux fois moins d’apports solaires que l’autre. Le schéma s’applique également sur les constructions à étages, notamment pour les immeubles on apprécie beaucoup plus les appartements traversants qui profitent de deux orientations plutôt qu’une seule et qui permettent une ventilation naturelle (lorsque le bâtiment est bien orienté évidemment).
L’intégration de l’inertie thermique 🧱
L’inertie thermique est un facteur clé dans la conception bioclimatique, les matériaux dits à forte inertie permettent de stabiliser l’intérieur du bâtiment car ils ont une forte résistance aux variations thermiques. Ces matériaux ont un haut déphasage thermique, c’est à dire, qu’il faudra un temps plus important pour faire varier leur température.
On calcule l’inertie thermique d’un matériau grâce à sa capacité thermique volumique ρC (en J/m3.K ou Wh/m3.K) multipliée par son épaisseur. Et pour une paroi complexe, on additionne l’inertie de chaque composant comme dans la formule suivante :
I = (ρCmatériau 1 x épaisseurmatériau 1) + (ρCmatériau 2 x épaisseurmatériau 2) + …
Plus l’inertie d’un matériau est grande, plus grande sera sa capacité à stocker de la chaleur ou à restituer de la fraîcheur.
En été, les matériaux à forte inertie permettront de conserver la fraîcheur à l’intérieur de la maison (à condition que ces matériaux ne soient pas exposés aux rayonnements solaires sinon on pourrait avoir l’effet inverse).
En hiver, ces mêmes matériaux stockeront de la chaleur la journée et joueront le rôle de parois accumulatrices pour la restituer dans la nuit et lors des journées nuageuses.
Ainsi, les différentes parois du bâtiment, selon leurs orientations nécessiteront plus ou moins d’inertie :
- au sud, l’inertie permettra le captage de l’énergie solaire et un déphasage lors de la restitution de cette énergie
- à l’ouest et en toiture, on recherchera plutôt le déphasage avec une isolation suffisamment dense
- et au sol, on cherchera une forte inertie pour stabiliser les températures de façon homogène entre les espaces avec un grand déphasage ici aussi.

La gestion des apports solaires passifs 🌞
Afin d’optimiser les calories et la luminosité offertes par le rayonnement solaire, les maisons bioclimatiques possèdent toutes une serre orientée au Sud.
Selon les constructions, la serre bioclimatique est :
- vitrée en parois verticales seulement
- vitrée en parois verticales et en paroi horizontale (toiture)
- comprend des châssis ouvrants en partie haute pour ventiler naturellement l’été
- s’ouvre totalement avec des baies ouvrantes (classique, coulissante ou accordéon)
- peut abriter un mur trombe, système de mur à forte inertie, en briques de terre crue par exemple, qui jouera le rôle d’accumulateur de chaleur
Cette serre est un espace tampon accumulateur de chaleur et de luminosité. On favorisera des vitrages les plus simples possibles entre la serre et les espaces de la maison car ils sont alors en second jour lumineux (car la lumière traverse deux baies).
Selon les habitations, cette serre bioclimatique peut être végétalisée, comme dans les earthship, ou simplement être un espace tampon où il est agréable de lire un livre dans un rockingchair.
L’organisation interne avec un zonage thermique 📊
Selon les usages, les pièces d’une maison n’ont pas les mêmes besoins en termes de température et de luminosité. Réfléchir un bâtiment avec la course du soleil et selon les besoins de chaque espace est un point clé de l’architecture bioclimatique.

Les pièces de vie, tels que le salon et la cuisine (les bureaux selon leurs usages), sont orientés au sud car ce sont les pièces qui nécessitent le plus de chaleur et de lumière du jour. Ainsi elles rayonnent et profitent des calories solaires gratuites de la serre.
Au plus proche, on positionne les chambres où l’on va chercher une température plus stable et plus basse qu’au salon pour avoir un meilleur sommeil. Selon les affinités et le rythme de vie des habitants, et bien sûr le climat local, on essayera de les positionner à l’Est afin de profiter de la lumière et de la chaleur du soleil levant.
Si l’on construit sur plusieurs étages, il pourrait être tentant de mettre les chambres à l’étage pour profiter l’hiver de l’air chaud qui monte mais il faudra porter très attention au traitement de l’isolation de la toiture pour ne pas se faire avoir par les chaleurs estivales.
Enfin les parties au nord seront réservées aux espaces non chauffés ou nécessitant peu de chaleur. On y positionne les garages, celliers, ateliers, sanitaires, circulations, buanderie, cellier, …, selon les besoins de lumière naturelle et les besoins thermiques.
Dans les habitats vernaculaires, on trouvait un dernier espace tampon : le grenier. Aujourd’hui, beaucoup apprécient le volume apporté par des espaces de toute hauteur mais gare aux surchauffes l’été et à la difficulté de chauffer l’hiver. Si vous pouvez conserver des combles non aménagées, c’est un très bon espace tampon qui vous apportera confort été comme hiver.
La valorisation de l’environnement et de la végétation 🌳
L’architecture bioclimatique s’ouvre sur le sud avec de généreuse ouvertures vitrées et il ne faut pas oublier de limiter les apports solaires directs lors de la saison estivale (et même au printemps et à l’automne selon certaines zones géographiques). Cela passe par divers aménagements :
- Calculer précautionneusement les débords de toiture avec les abaques de trajectoire du soleil selon votre position géographique
- Planter des arbres à feuilles caduques pour apporter de l’ombre l’été
- Planter des végétaux grimpants au dessus d’une pergola pour apporter de l’ombre à la serre
- Implanter une pergola bioclimatique avec des lames orientables pour ombrager la serre
En utilisant les atouts du terrain, vous pouvez aussi positionner votre maison bioclimatique dans la pente, avec les espaces techniques semi-enterrés ou enterrés, à l’image des earthships, ce qui apportera une forte inertie à la construction et la protègera des vents.
Pour protéger le bâti des vents, utilisez la déclivité du terrain et l’implantation de végétation (arbres ou haies).

L’usage de la ventilation naturelle 🍃
La ventilation est très importante dans les constructions, elle permet le renouvellement de l’air intérieur et ceci influe donc sur sa qualité. Elle permet l’évacuation de l’humidité, des fumées, des biocontaminants, du CO2, des COV, etc et améliore ainsi la santé des occupants.
Le but de l’architecture bioclimatique étant de construire en relation avec l’environnement local et limiter son impact énergétique, il est préférable d’optimiser une ventilation naturelle éventuellement couplée à une simple VMC hygroréglable plutôt que d’installer une VMC double flux demandant plus d’énergie électrique et de matériaux issus de la métallurgie.
A noter qu’après de nombreuses visites de constructions bioclimatiques, selon les matériaux mis en oeuvre et les habitudes de vie des occupants, on peut facilement se passer de cette ventilation contrôlée et tout miser sur la ventilation naturelle.
Si vous êtes dans une zone géographique concernée par des vents dominants, comme vu dans la carte précédente, il sera optimal de venir trouver sur l’axe des vents une prise d’air d’entrée basse et une prise d’air de sortie haute pour une ventilation naturelle par balayage.
Sur une ventilation naturelle par l’ouverture des fenêtres, Minergie (label suisse pour le confort) préconise des ouvertures de courtes durées (30 secondes à 3 minutes) mais bien plus régulièrement qu’on ne l’imagine :
- Toutes les 2 heures pour un séjour normal ou pour une chambre à coucher
- Toutes les 1/2 heures pour un séjour avec fumeur
- Toutes les 20 minutes pour une salle de classe de 25 élèves
D’où la recommandation de coupler la ventilation naturelle à une VMC hygroréglable pour évacuer l’humidité des pièces humides (cuisine, salle de bain et sanitaires).
Le choix de matériaux adaptés au climat local 🌦️
Selon la zone géographique de votre projet, certains matériaux seront plus intéressants que d’autres. La conception bioclimatique à l’origine ne prescrivait pas des matériaux particulièrement locaux mais cela tombe sous le sens. Regardez et observez l’architecture traditionnelle locale, vous y trouverez les matériaux locaux qu’utilisaient les anciens.
Observez les façades, sont elles en terre crue ? Sont-elles en colombage ? Sont-elles en chaux ? Sont-elles bardées ?
Observez les toitures, sont-elles en ardoise ? Sont-elles en chaume ? Sont-elles en tuiles de terre cuite ? Sont-elles en bardeaux ? Sont-elles en zinc ?
Quelles en sont les matières premières ? Et où sont-elles produites ? Comment s’en procurer ?
Selon votre région, vous ne construirez pas avec le même bois, vous n’enduirez pas avec le même matériau, vous n’aurez pas la même couverture. Il y a des systèmes reproductibles à divers endroits mais chercher des biosourcés les plus locaux possible permet de limiter l’impact environnemental de votre chantier.
C’est ainsi un choix écologique fort : réduction des émissions liées au transport, soutien aux filières locales, relocalisation de savoir-faire.
C’est un choix important pour le bois car les essences locales ont évolué dans le même climat que celui où elles seront utilisées. Cela signifie que leurs propriétés mécaniques, leur comportement face à l’humidité, aux variations de température ou aux UV sont naturellement adaptés. De plus, le douglas, le châtaignier et le mélèze n’ont pas besoin de traitement et pourront être laissés bruts contrairement à certains bois importés qui auront subi des traitements industriels et non adaptés au climat local. Enfin le bois local sera plus frais et moins dégradé (par le transport et les possibles expositions au soleil et aux intempéries) et avec une meilleure traçabilité.
L’utilisation de techniques bioclimatiques spécifiques 🛠️
Pour améliorer le confort dans la maison sans surconsommer d’énergie, certaines techniques dites « bioclimatiques » peuvent être intégrées dès la conception ou lors d’une rénovation. Ces solutions, souvent simples et inspirées du bon sens, utilisent les ressources naturelles (soleil, vent, chaleur du sol…) pour chauffer, rafraîchir ou ventiler les espaces. En voici quelques-unes :
- Le mur capteur-accumulateur (ou mur Trombe) 🧱
C’est un mur épais à forte inertie placé côté sud, protégé par une vitre. Le soleil chauffe l’air entre la vitre et le mur, et celui-ci emmagasine cette chaleur dans la journée, puis la diffuse lentement à l’intérieur quand la température baisse.
Cela permet un chauffage gratuit l’hiver. Par contre il faut bien protéger ce vitrage l’été et le faire ventiler pour qu’il ne chauffe pas et au contraire restitue la fraîcheur. - La serre bioclimatique 🌿
Cette pièce vitrée accolée à la maison fonctionne comme une bulle de chaleur. Elle capte les rayons du soleil et peut ensuite réchauffer naturellement les pièces voisines. En bonus, elle peut aussi servir de jardin d’hiver ou d’espace détente. - Les capteurs à air ou « windcatchers » 💨
Ces tours de ventilation, souvent utilisées dans les pays chauds, attrapent le vent au-dessus du toit et le guident à l’intérieur de la maison. Cela permet de créer une ventilation naturelle agréable, sans bruit ni consommation d’énergie. - Le puits canadien (ou puits provençal) 🌍
Ce système de ventilation passive utilise la température constante du sol. L’air extérieur circule dans des tuyaux enterrés, ce qui le réchauffe en hiver ou le rafraîchit en été avant d’entrer dans la maison.
Chacun de ces dispositifs peut être adapté selon le climat local, les habitudes des habitants et le type de bâtiment. Ils font partie de la boîte à outils de l’architecture bioclimatique, qui vise toujours à concilier bien-être et sobriété énergétique.

L’approche de Papaya Architecture pour votre projet d’architecture bioclimatique
Un accompagnement global pour votre projet 🌸
Chez Papaya Architecture, chaque projet commence par une écoute attentive de vos besoins, de vos envies et de votre mode de vie. L’architecture bioclimatique n’est pas une recette toute faite : c’est une réponse sur-mesure, co-construite avec vous, en prenant en compte votre terrain, votre budget, vos usages et votre sensibilité écologique.
De la première esquisse jusqu’au suivi du chantier, je vous accompagne pas à pas, en expliquant les choix, en vulgarisant les notions techniques, et en vous guidant vers des solutions simples, efficaces, et cohérentes avec vos valeurs.
La sensibilité à l’environnement local 🌿
Chaque lieu a sa propre lumière, ses vents dominants, ses saisons, ses matières… C’est en observant finement le climat et le site, en analysant son orientation, ses vues, sa végétation, que je conçois un projet enraciné, qui fait corps avec son environnement.
Cette sensibilité au génie du lieu permet de créer une architecture à la fois sobre, vivante et profondément respectueuse de son écosystème. On parle ici d’habitat qui respire avec la nature, et non contre elle.
L’utilisation des matériaux biosourcés 🌾
Les matériaux jouent un rôle fondamental dans la qualité d’un habitat. Chez Papaya Architecture, je privilégie des matériaux biosourcés, locaux quand c’est possible. Je les choisis spécifiquement pour chaque projet selon leurs spécificités propres, leurs performances thermiques, leurs performances hygrométriques et encore bien d’autres paramètres. Et surtout je suis engagée dans ces choix de matériaux pour leur faible impact environnemental et leurs avantages sur le confort et la santé.
Bois massif, paille, terre crue, chaux, ouate de cellulose, fibres végétales… Ces matériaux offrent non seulement un excellent confort intérieur, mais aussi une atmosphère chaleureuse et saine. Ils participent activement à l’équilibre du bâtiment tout en soutenant une économie plus vertueuse.
Conclusion
L’architecture bioclimatique, ce n’est pas une tendance passagère : c’est une manière engagée, durable et profondément humaine d’habiter le monde.
Chez Papaya Architecture, je m’investis chaque jour pour concevoir des lieux de vie à la fois performants, sensibles et adaptés à votre réalité. Mon rôle, en tant qu’architecte HMONP spécialisée dans l’écoconception, est de vous accompagner avec sérieux et bienveillance, en traduisant vos besoins et vos envies dans une architecture à la fois cohérente, esthétique et respectueuse de l’environnement.
🌱 Je me forme et m’informe en continu sur les solutions les plus pertinentes en matière d’écoconstruction, de rénovation écologique, de matériaux biosourcés, de réglementation thermique ou de santé dans l’habitat.
🌿 Je teste, j’expérimente, je visite régulièrement des bâtiments inspirants, et je mets à jour mes connaissances pour toujours vous proposer les choix les plus éclairés et adaptés à votre projet.
✨ Et surtout, je m’engage à vos côtés, avec exigence, passion et pédagogie, pour faire de votre habitat un lieu sain, agréable à vivre et résilient.
Envie de concevoir un habitat bioclimatique qui vous ressemble, ici et maintenant ?
Je serais ravie d’échanger avec vous et de mettre mes compétences au service de votre projet pour imaginer ensemble le lieu pour vous épanouir.

Merci à vous d’avoir lu cet article ! 🌿
Vous cherchez de l’inspiration ? Découvrez au fil de mes articles de visites de chantier des exemples marquants d’architectures bioclimatiques en terre, bois et paille.
Et si vous souhaitez vous offrir un ouvrage détaillé sur l’architecture bioclimatique, je vous recommande fortement La conception bioclimatique: Des maisons confortables et économes de Samuel Courgez et Jean-Pierre Oliva (39€TTC) et le Manuel d’Architecture Naturelle de D.Wright (14€TTC).
FAQ – pour aller plus loin 🌿
Quelles sont 3 erreurs fréquentes à éviter dans une conception d’architecture bioclimatique❓
- Une orientation négligée
Comme expliqué dans cet article, l’orientation est la première base, comme la première pierre pour un projet d’architecture bioclimatique. Une maison mal orientée entraînera un déséquilibre qu’il faudra compenser par une augmentation du chauffage ou du rafraîchissement. Par exemple, une maison avec toutes les pièces de vie tournées vers le nord manquera d’apports solaires passifs et augmentera les besoins en chauffage et en éclairage artificiel. - Un mauvais choix de matériaux
Utiliser des matériaux inadaptés au climat ou à faible inertie thermique (comme du béton mal isolé) peut compromettre le confort d’été comme d’hiver.
Ce n’est pas parce qu’on utilise des matériaux écologiques qu’ils seront bioclimatiques, il faut avant tout réfléchir à l’adéquation avec l’environnement et le climat local pour choisir le bon matériau au bon endroit. - Une conception mal anticipée
Tout est question de vision d’ensemble et d’autant plus dans un projet d’architecture bioclimatique. Une bonne implantation sur le terrain, une organisation intérieure adaptée au cycle solaire, des protections solaires bien dimensionnées… tout cela se conçoit dès l’esquisse avec l’architecte.
Quel est le coût d’une maison bioclimatique❓
Le coût d’une maison ne se calcule pas seulement à la construction ou à l’achat, il faut avoir une vision élargie des dépenses, incluant le coût de fonctionnement.
Effectivement selon les matériaux choisis, le niveau de finition et les potentiels systèmes passifs spécifiques ajoutés, une maison bioclimatique peut coûter autant qu’une maison classique, voire un peu plus à la construction. Mais elle permet de réduire considérablement les factures énergétiques, ce qui compense le budget sur le long terme.
✅ Sans compter qu’elle offre un meilleur confort thermique, un meilleur bien-être et une meilleure santé à ses habitants et en plus, cela apporte une valeur ajoutée à la revente.
Peut-on faire une maison bioclimatique en autoconstruction❓
Oui, c’est possible, à condition d’avoir une bonne préparation. De nombreux autoconstructeurs se lancent dans des projets bioclimatiques, souvent en bois, terre, paille ou autres matériaux naturels.
‼️ Il est fortement recommandé de faire appel à un architecte pour la conception, au moins en phase esquisse et permis, afin d’éviter les erreurs structurelles ou thermiques coûteuses. Ensuite, les travaux peuvent être réalisés progressivement, avec ou sans chantier participatif.
De plus, il est intéressant d’aller expérimenter d’autres chantiers d’autoconstruction avant de vous lancer dans le votre. Vous trouverez de nombreux exemples de projets en cours sur le réseau Twiza, vous verrez ainsi les différences entre les chantiers qui sont accompagnés par des professionnels de la construction (architecte, amo, maçon, compagnon, etc.) et ceux qui se lancent seuls. Vous y trouverez d’ailleurs un annuaire cartographié des professionnels accompagnateurs de chantiers d’autoconstruction en France.
Peut-on faire une rénovation bioclimatique❓
Absolument. Même si le bioclimatisme s’applique plus naturellement à la construction neuve, la rénovation bioclimatique est possible, en particulier sur des bâtis anciens bien orientés.
✏️ Il s’agira d’optimiser les apports solaires, l’amélioration de l’inertie et les renforcements de l’isolation, tout en respectant les caractéristiques du bâtiment existant et en s’adaptant au climat local. Une rénovation bien pensée vous offrira des performances proches d’une maison neuve (voire supérieures) !
Quelle est la différence entre architecture bioclimatique et architecture passive❓
- L’architecture bioclimatique s’adapte au climat local en maximisant les ressources naturelles (soleil, ombre, vent, végétation…) pour offrir un confort thermique sans surconsommer. C’est une démarche de conception écosensible, avec une approche autour du climat local et des ressources naturelles disponibles.
- L’architecture passive va plus loin : elle suit des normes précises (comme le Passivhaus) visant une consommation énergétique quasi nulle, souvent avec une enveloppe ultra-performante et une ventilation double flux. Elle nécessite de suivre une démarche certifiée conduisant à un label.
L’architecture passive est plus technique, tandis que l’architecture bioclimatique est plus contextuelle et parfois plus low-tech.
Toute maison passive est bioclimatique mais l’inverse n’est pas forcément vrai car il n’y a pas de visée spécifique de performance et de certification dans une démarche d’architecture bioclimatique.






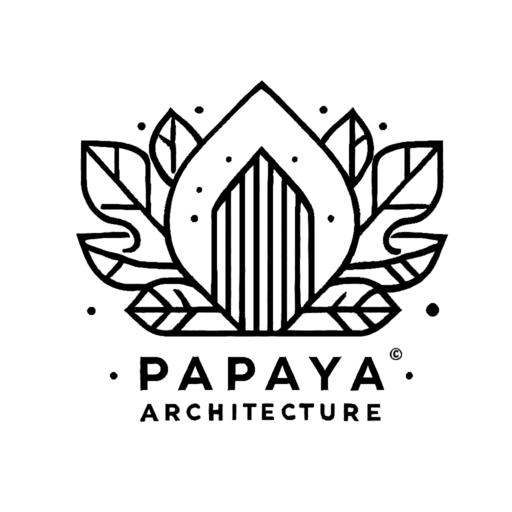




Laisser un commentaire